Blog #6 (3/3) - La fête de la Huaconada, un récit personnel et ethnographique
- Gabriel LAUDE
- 5 janv. 2024
- 22 min de lecture
Dernière mise à jour : 1 janv.

Après avoir fait la découverte du village de San Jerónimo de Tunán où habitaient mes ancêtres autrefois [cf. partie 1/3] et avoir fait la rencontre inattendue de Lucho, un vieux monsieur à la générosité débordante, dans le petit village de Mito [cf. partie 2/3], je raconte à mes amis Tom et Jade mon expérience de la fête ancestrale de la Huaconada de Mito, troisième et dernière étape de mon voyage initiatique dans la vallée du Mantaro. Accompagné de Lucho, j’ai pu vivre cette fête de l’intérieur, jusqu’au point de devenir un protagoniste de celle-ci…
San Jerónimo de Tunán, vendredi 5 janvier 2024
Cher Tom et chère Jade,
J’espère que vous allez bien. Je vous écris depuis San Jerónimo de Tunán, le village de mes ancêtres, où je suis revenu passer quelques jours pour participer à la fête de la Huaconada [1] de Mito que j’ai connu pour la première fois l’an passé. J’aimerais partager avec vous ma première expérience de cette festivité populaire qui se déroule tous les ans du 1er au 4 janvier dans la commune de Mito appartenant à la province de Concepción dans la vallée du Mantaro. Cette fête est très spéciale car durant celle-ci les miteños (nom des habitants de Mito) réalisent la danse rituelle de la Huaconada, une tradition millénaire qui a été nommée « Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité » par l’UNESCO en 2010. Cette danse est réalisée autour de la place centrale de Mito par des groupes d’hommes masqués appelés huacones. Les huacones qui représentent l’ancien conseil des anciens du village deviennent la plus haute autorité de Mito le temps que dure la fête. Ils détiennent ainsi le pouvoir de châtier de leur fouet n’importe quelle homme qui se serait mal comportée au cours de l’année selon la tradition - les femmes quant à elle sont épargnées par les coups de fouet en principe. Accompagné de Lucho, un vieux monsieur à la générosité débordante que j’ai rencontré à Mito, j’ai pu vivre cette fête de l’intérieur, jusqu’au point de devenir un protagoniste de celle-ci…
Dimanche 1er janvier 2023
Que la fête commence !
05 :00 – Je me réveille soudainement. L’espace d’un instant, je ne sais pas où je suis. Je regarde autour de moi et reprends doucement mes esprits. La migraine terrible qui m’envahit est là pour me rappeler ma soirée arrosée de la veille [cf. partie 2/3]. Une musique entraînante résonne au loin. Manifestement, les célébrations du Nouvel An ne sont pas encore finies pour tout le monde. Il fait encore nuit noire. J’essaye de me rendormir malgré l’excitation qui commence à poindre en moi. Dans quelques heures, la fête de la Huaconada va commencer !
09 :00 – À neuf heures précises, me voilà sur la place principale de Mito muni de mon appareil photo, prêt à assister au début de la fête. Une mélodie résonne au loin accompagnée d’un bruit de tambour régulier. Ce sont eux ! Je regarde sur ma gauche et aperçois les huacones remonter la rue principale de Mito accompagnés d’un orchestre. Je m’approche hâtivement et sors mon appareil photo tel un reporter en mission. Je prends un nombre incalculable de photos et de vidéos, je ne veux rien perdre de ce moment si spécial. J’en avais déjà vu en photo, mais les voir danser en direct, accompagné par l’orchestre, et sur la place principale de Mito qui plus est, c’est tout à fait autre chose. Je les trouve à la fois majestueux et inquiétants avec leurs costumes élaborés et leurs masques à l’expression hostile. Les huacones qui ouvrent la marche sont les caporales (« caporaux »), ce sont eux qui organisent la fête cette année. Chaque année, cette responsabilité est confiée à une famille différente. L’orchestre qui les accompagne est composé d’une dizaine de saxophones, de deux clarinettes, d’un violon, d’une harpe et d’une tinya, un petit tambour typique des Andes centrales dont l’origine est très ancienne.
L'arrivée des huacones à la place principale de Mito.
Typologie des huacones
Il existe deux types de huacones, les huacones modernes et les huacones anciens. D’une part, on peut les distinguer par leur accoutrement. Les huacones modernes portent des habits aux couleurs vives et, pour certains d’entre eux, leur tablier possède un motif brodé, signe qu’ils sont mariés. De plus, les traits de leurs masques sont similaires à ceux des conquistadors : un nez imposant, une moustache et une expression de terreur, de tristesse ou de rire. Les huacones anciens ont quant à eux des habits aux couleurs ternes (blanc, gris ou beige) et les traits de leur masque sont ceux d’un vieillard inspirant le respect ou la peur. On peut aussi les distinguer par leur manière de danser. Les huacones modernes effectuent une marche sur la pointe des pieds au rythme de la tinya comme s’ils montaient à cheval et, lors des deux variations qui caractérisent la mélodie de la Huaconada, ils font virevolter leur cape tel les ailes d’un condor et s’arrêtent brièvement, puis reprennent leur marche régulière. Ils répètent ce motif inlassablement jusqu’à avoir réalisé le tour complet de la place principale (ce qui dure environ une demi-heure), provoquant une sensation d’hypnotisme lorsqu’on les regarde de manière continue. Les huacones anciens ont quant à eux davantage de liberté dans leurs mouvements, mais doivent garder une posture courbée imitant celle d’un vieillard. En revanche, les deux types de huacones sont empreint de la même autorité, et adoptent tous deux une voix de fausset grave lorsqu’ils s’expriment, ce qui permet à la fois d’occulter l’identité des danseurs et d’incarner le personnage du huacón. Il n’y a pas d’âge requis pour interpréter l’un des deux personnages, mais il y a toujours beaucoup plus de huacones modernes que d’anciens. Seuls les hommes de bonne conduite et d'une grande intégrité morale peuvent être huacones. Traditionnellement, la danse est transmise de père en fils et les costumes et masques sont hérités. Aujourd'hui, cependant, le processus pour devenir huacón est plus ouvert.
Quelques huacones modernes aux splendides tabliers brodés.
Une figure d’autorité

Les huacones sont des figures d'autorité. Par conséquent, pour s'adresser à eux, il faut utiliser l'appellation Señor Alcalde (« Monsieur le Maire »), tandis qu'entre eux, les huacones s'appellent par le terme compañero (« camarade »). Par ailleurs, quand le public s’approche un peu trop près d’eux, les huacones peuvent s’énerver et devenir menaçant en tapant de leur fouet sur le sol. Il est difficile de savoir si cet énervement est feint ou réel, mais mieux vaut ne pas les provoquer car ils ont le pouvoir de punir de leur fouet n’importe quel homme du public, et cela de manière tout à fait discrétionnaire. Dans ce cas, ils pointent l’homme en question du doigt et l’interpellent d’un Hamuy, hamuy ! (« viens, viens ! » en quechua) jusqu’à ce que la personne désignée se présente à eux. Ils lui donnent alors un coup de fouet plus ou moins fort au niveau des jambes avant d’étreindre amicalement la personne. Toutefois, ces « punitions » prennent souvent un caractère humoristique et le coup de fouet est rarement très douloureux. Les huacones peuvent également se « punir » entre eux, soit de manière amicale, soit lorsqu'ils considèrent qu'un autre huacón ne respecte pas la tradition, si ce dernier n'adopte pas une attitude adéquate ou si sa tenue n'est pas correcte. Ainsi, les huacones sont théoriquement la plus haute autorité de Mito le temps que dure la fête de la Huaconada, du 1er au 4 janvier. Cela donne lieu à des scènes cocasses, comme lors de la cérémonie d’investiture du nouveau maire de Mito qui s’effectue tous les trois ans le 1er janvier et qui avait lieu justement cette année-là. Alors que les huacones effectuent leur danse autour de la place, on peut entendre la voix du présentateur de cérémonie en fond, provoquant la colère d’un des huacones qui tape de son fouet sur le sol en criant « Esto es Huaconada ! » (« C’est la Huaconada ! »), un message adressé explicitement au présentateur, l’obligeant à s’excuser de la coïncidence des deux événements. Puis, avant que le maire ne soit officiellement investi, il est traditionnel que l’un des caporales prenne le microphone et informe le maire de ses exigences pour le mandat à venir, et lui donne un coup de fouet, comme pour rappeler l’autorité morale que représentent les huacones à Mito et, en particulier, durant la fête de la Huaconada. Si l'on en croit plusieurs miteños, cette menace latente permet de préserver Mito de toute forme de corruption, un prodige pour le Pérou.

Le maire prêtant serment face au caporal.
Un drôle de spectacle
12 :00 - Un autre moment habituel de cette première journée de fête, c’est la escaramuza ou caramuza (de l’italien scaramuccia qui signifie un combat bref et de peu d’importance, n’étant pas décisif). Ce spectacle prend place aux alentours de midi dans le colisée de Mito et rassemble plusieurs dizaines de huacones qui réalisent des numéros par deux qui alternent entre le spectaculaire et le burlesque. Ce spectacle, s’il ne relève pas de la tradition de la Huaconada, se révèle néanmoins assez amusant. En tout cas, son succès est incontestable, comme en témoigne les rangées de gradins remplies à craquer. Le clou du spectacle intervient à la fin de la escaramuza, lorsque des huacones se succèdent pour tenter de délivrer un sac plein de billets niché en haut d’un poteau en bois faisant plusieurs mètres de hauteur. Une fois ce prodige accompli, le spectacle s’achève et la fête reprend son cours.
Petit interlude alcoolisé
Comme dans la plupart des festivités andines, la bière constitue un élément central des célébrations. Ainsi, sur la place principale de Mito, les gens forment des cercles d’interconnaissances au milieu desquels il ne manque jamais de bouteilles de bière. Lorsqu’on croise quelqu’un que l’on connaît dans un cercle, il est très courant de se faire inviter à rejoindre celui-ci pour partager ses bières. Difficile de refuser car se serait très mal vu, à moins d’avoir une bonne excuse, car c’est une manière de montrer son affection pour la personne que l’on croise. C’est pourquoi, quand une personne amène une ou plusieurs bouteilles de bière, on dit que c’est son cariño (« tendresse » ou « affection »). En retour, il est aussi attendu de manière implicite des personnes formant le cercle qu’elles invitent d’autres bouteilles de bière quand celles-ci viennent à manquer, créant ainsi une dynamique potentiellement infinie. Il faut donc prévoir de l’argent en conséquence pour pouvoir rendre le cariño que l’on nous témoigne et ne pas risquer d’être mal vu. Au sein du cercle, tout le monde est muni d’un verre en plastique, et lorsqu’une bouteille arrive à nous, il faut se servir (ou faire semblant du moins si l’on ne souhaite pas boire) et tendre la bouteille à son voisin de droite. Si l’on boit son verre trop lentement, il est possible de se faire apostropher amicalement par l’interjection Upyay, upyay (“bois, bois” en quechua). Avant la crise du Covid, paraît-il, il n’y avait qu’un seul verre au sein d’un cercle, et celui-ci tournait en même temps que la bouteille, il fallait donc se servir, boire son verre, puis le tendre avec la bouteille à son voisin.
La Huaconada s’empare de mon corps
16 :00 – À la fin de la journée, j'ai tant observé la danse de la Huaconada, que je me mets moi-même à exécuter quelques pas de danse de manière naturelle, comme si je commençais à être habité par celle-ci. En me voyant, Lucho me demande :
- Tu aimerais danser ?
- Euh… Je ne sais pas… Oui… Ça serait possible ?
- Je vais voir si je peux te trouver une tenue pour demain. Mais tu es sûr que tu as envie ?
- Si c’est possible, alors oui, je serais ravi de pouvoir danser !
- On verra demain dans ce cas.
Lundi 2 janvier 2023
Une opportunité inespérée
12 :00 – On boit tranquillement des bières au soleil avec des amis de Lucho quand soudain, celui-ci reçoit un appel. Il parle quelques instants, raccroche, puis se tourne vers moi. « C’est bon, je t’ai trouvé un costume. Tu veux toujours danser ? ». Je n’avais pas oublié le moins du monde la proposition faite hier par Lucho, mais je dois avouer que les heures passant, j’avais un peu perdu espoir de trouver un costume et m’étais donc résigné à ne pas danser. Alors que l’opportunité semble enfin se concrétiser, le doute m’assaillit. Ai-je vraiment envie de danser ? Ou plutôt, en serais-je capable ? « Alors, tu te décides ? » me relance-t-il. Je décide de ne pas écouter mes pensées et de plutôt me fier à mon instinct qui a toujours été un excellent guide jusqu’à présent. « Allons-y. » lui dis-je. Nous descendons la rue principale et nous arrêtons devant l’une des dernières maisons avant l’entrée du village. Lucho frappe à la porte. « Benito ! Ouvre, c’est nous ! » crie-t-il. Un homme d’une soixantaine d’années nous ouvre. Il me dévisage d’un air suspicieux puis nous fait signe d’entrer. Nous accédons à un jardin. Lucho lui explique la situation : « Benito, c’est pour lui le costume. C’est un français qui apprécie particulièrement la Huaconada, il est venu à Mito tout spécialement pour connaître la fête. Nous nous sommes rencontrés le 31 décembre dernier et nous avons très vite sympathisé. C’est un bon garçon, il va faire ça très bien, tu verras. » Benito semble hésiter. Il me regarde puis me questionne sur mes intentions. Je lui explique à nouveau la situation en essayant de paraître le plus sincère possible. Après m’avoir écouté, il ajoute : « La Huaconada c’est sérieux, c’est pas un jeu. Une fois que tu es sur la place, il faut que tu assures, on peut pas se permettre que tu nous foutes la honte, c’est compris ? » J’acquiesce, un peu chamboulé. Je sais bien qu’il ne fait pas ça pour m’intimider mais pour me faire comprendre la responsabilité qui m’incombe si je souhaite devenir huacón. Il n’est plus temps de faire machine arrière, j’ai pris ma décision quoi que celle-ci en coûte. Il ajoute ensuite d’un air plus chaleureux : « Asseyez-vous, je vais vous amener à manger. »
La préparation
Benito rentre dans la maison et ressort quelques instants plus tard en portant deux bols de soupe remplis à ras bord dont s’échappe un délicieux fumet. Il nous en tend un à chacun et nous invite à manger. C’est un caldo de cordero, un potage typique de la région andine à base de légumes, de pomme de terre, de riz et d’agneau. Même s’il fait un grand soleil, je me délecte de ce potage réconfortant et revigorant. Pendant ce temps-là, un ami de Benito se présente chez lui. Ce dernier l’invite également à s’asseoir pour manger et lui demande par la même occasion d’aller chercher des bières car « la boisson aide à danser de manière plus relâchée et plus enjouée » dit-il en s’adressant à moi. Quand nous avons tous fini de manger, Benito s’en va chercher le costume afin que je m’habille. J’ai déjà vu à peu près à quoi ressemble la tenue d’un huacón moderne mais cela ne m’empêche pas d’être surpris à la vue de toutes les pièces que Benito apporte une après une. Heureusement que ce dernier est là pour me guider. Dans un premier temps, j’enfile le pantalon d’équitation et la chemise blanche, les chaussettes et les manches tricotées, puis les chaussures.
Jusqu’ici, j’ai pu me débrouiller tout seul. C’est là que les choses se compliquent. Benito m’aide à attacher le foulard noir autour de ma tête de telle sorte à ce que l’on ne puisse voir que mes yeux. Il m’attache ensuite un tablier bleu dont la couleur est assortie aux manches, chaussettes et chaussures. Il m’attache enfin une cape qui est en réalité une couverture en laine aux motifs tigrés pesant assez lourd. Pour finir, je place le masque sur ma tête et le chapeau par-dessus en prenant soin d’attacher celui-ci en dessous du nez du masque de huacón pour être sûr qu’il ne tombe pas. Me voilà prêt ! L’ami de Benito se montre particulièrement dithyrambique quant à mon allure. « Chocolate ! » (« chocolat ») s’exclame-t-il pour signifier son approbation. Il insiste sur ma taille qui, selon lui, est excellente pour un huacón. Je m’en amuse car je n’ai pas eu l’habitude d’être remarqué pour ma taille en France. Un peu après arrive Percy que j’ai rencontré le 31 décembre dernier [cf. partie 2/3], et qui a accepté d’être mon parrain de Huaconada. Il est déjà en tenue. Il vient tout de suite me voir et me dit : « J’ai bien réfléchi à ton nom de baptême, ce sera Puka Amaru. Puka (« rouge » en quechua) car nous partageons tous les deux les idéaux du socialisme, Amaru (« serpent » en quechua) en référence à Túpac Amaru [2] car toi aussi tu as cet esprit rebelle en toi. » Je suis touché par ses paroles. Nous répétons ensuite les pas de la danse dans le jardin de Benito. Je suis extrêmement concentré, je sens au plus profond de moi-même la responsabilité qui m’incombe, non seulement auprès de mes « protecteurs », mais aussi auprès de la tradition millénaire de la Huaconada. À présent, il est temps de rejoindre la danse.
Je rejoins la danse…

Nous sortons de chez Benito avec Percy et remontons la rue principale qui mène à la place. À mesure que l’on se rapproche, la foule se fait de plus en plus dense et les commerces s’agglutinent le long de la rue. À travers les deux petits trous de mon masque, je ne vois qu’à 5 mètres devant moi. J’essaye de bouger régulièrement la tête pour regarder autour de moi et par terre car j’ai du mal à me situer. Je redoute de trébucher ou de rentrer dans quelque chose ou quelqu’un. À notre passage, tous les regards sont braqués sur nous, une aura spéciale semble se dégager du costume. Cela me rassure de me dire que personne ne peut déceler la peur qui m’envahit à travers le masque, les gens me perçoivent comme un huacón à part entière. Après s’être difficilement frayé un chemin à travers la foule, nous parvenons sur la place. Des huacones accompagnés par l’orchestre ont déjà entamé le tour de la place, nous nous joignons à eux en effectuant les pas de danse caractéristiques. Heureusement, les pas de danse ne sont pas très compliqués, ce qui est moins naturel en revanche, c’est de rentrer dans le personnage du huacón. Il faut ainsi danser avec prestance conformément à notre statut d’autorité puis, quand vient l’une des deux variations de la mélodie, il faut se couvrir avec la cape tel un condor et finir le mouvement par un rugissement à la manière d’un jaguar.

Le huacón est également libre de taper le sol de son fouet ou de désigner un homme de la foule pour le fouetter comme je l’ai déjà mentionné précédemment. Pour être sincère, je n’ai pas fait usage de cet attribut pour cette première fois. Je ne me sentais pas assez en confiance pour le faire et j’ai préféré me concentrer sur la danse avant de m’accorder d’autres libertés. Ce qui est difficile aussi, c’est de devoir danser de manière continue jusqu’à ce que le tour de place soit fini, soit pendant environ une demi-heure. En plein soleil, j’étouffe très vite sous le masque et sue abondamment dans mes habits. Qui plus est, l’altitude rend l’effort encore plus difficile qu’il ne l’est déjà. Il faut pourtant résister malgré la fatigue et la douleur, et surtout, conserver une attitude digne d’un huacón. Par ailleurs, je m’inquiète qu’un élément de ma tenue soit mal mis ou se soit enlevé pendant la danse car je n’ai aucun moyen de le savoir sauf si quelqu’un du public ou un autre huacón s’en aperçoit et décide de me venir en aide. C’est justement ce qui m’est arrivé pendant ce premier tour de place, un huacón expérimenté est venue me voir discrètement et m’a aidé à remettre ma cape et mon masque qui n’étaient pas tout à fait bien positionnés. À la fin du tour, avant même que je puisse enlever mon masque pour souffler, plusieurs personnes m’interpellent pour me demander des photos, j’ai l’impression d’être une célébrité. Ensuite, vient enfin une pause qui dure environ une vingtaine de minutes, et durant laquelle les huacones se retrouvent entre eux ou avec leurs proches pour boires quelques bières avant de repartir. Il y a deux orchestres différents qui se relaient à chaque tour de place pour que les musiciens puissent avoir eux aussi le temps de se reposer. Aux alentours de 17 heures, une fois le dernier tour de place achevé, prennent place les cérémonies du corta rabo (littéralement, « la coupe de queue ») durant lesquelles sont baptisés les nouveaux huacones. Comme vous pouvez vous en douter, j’ai eu le droit moi aussi à mon baptême de huacón, une cérémonie pour le moins singulière.
Le « corta rabo », un baptême pour le moins singulier
17 :00 - Avant le début du corta rabo, Percy, Lucho et Benito font appels à leurs proches et notamment à d’autres huacones expérimentés pour m’entourer durant cette cérémonie. Avant cela, ils se sont assurés que l’un des deux orchestres était prêt à jouer le temps du baptême. Une fois tous réunis en cercle au niveau de l’église, l’orchestre commence à jouer la mélodie traditionnelle de la Huaconada pendant qu’un huacón m’entoure de son fouet pour ne pas que je m’échappe. Ensuite, un autre huacón me porte sur son dos et quelqu’un soulève ma cape pour découvrir le bas de mon corps. Je ne vois absolument rien à travers mon masque et je serre les dents dans l’attente fatidique des coups de fouets que s’apprête à me donner Percy, mon parrain. HUITSCHHH. Premier coup de fouet. Une douleur vive s’empare de mon fessier. Des cris et des rires s’élèvent dans la foule. HUITSCHHH. Deuxième coup de fouet. HUITSCHHH. Troisième coup de fouet. La foule exulte. J’ai mal, mais la fierté l’emporte sur la douleur. Ça y est, je suis officiellement huacón ! On me ramène à terre, puis je m’en vais étreindre Percy.
Ensuite, la tradition veut que le nouveau huacón et son parrain payent chacun une caisse de bières pour remercier les proches qui étaient présents lors du baptême et les musiciens qui ont accepté de jouer. Les bières payés par le filleul sont appelées la sangre (« le sang ») et celles payées par le parrain el sebo (« la graisse »). Petit problème, je n’avais pas anticipé ce paramètre et j’ai dépensé presque toutes mes liquidités... J’en informe discrètement Percy qui commence à s’affoler, ce serait un déshonneur absolu de ne pas avoir deux caisses de bières à offrir aux participants ! Il n’a pas assez d’argent sur lui pour payer les deux caisses et négocie discrètement avec la vendeuse : « Je te laisse mon téléphone en garanti et je te ramène l’argent un peu plus tard, s’il-te-plaît, fais-nous cette faveur. » Elle accepte. Ouf ! Nous voici soulagés avec Percy. Personne n’a remarqué le subterfuge et la cérémonie peut reprendre de plus belle. Nous apportons les deux caisses au centre du cercle qui s’est formé et nous distribuons plusieurs bouteilles aux personnes présentes en commençant par les musiciens. La suite ne présente pas vraiment de surprise, tout le monde boit allègrement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus à boire et que quelqu’un ramène à nouveau d’autres bouteilles et ainsi de suite jusqu’à qu’il ne reste plus personne. De mon côté, je ne fais pas fait long feu, vers 19 heures j’entreprends de rentrer avec Lucho pour me changer et préparer mes affaires car je dois rentrer à San Jerónimo le soir-même pour prendre mon bus de retour pour Lima le lendemain. Je fais mes adieux à Lucho rempli d’émotion, heureux d’avoir fait sa rencontre et d’avoir pu connaître la fête de la Huaconada d’une manière dont je n’aurais même pas pu rêver, mais triste de le quitter et de quitter le sympathique village de Mito. Dans l’ivresse du moment, je lui promets de revenir le voir à Mito très prochainement et de revenir danser l’année prochaine…
Mardi 3 janvier 2023
Un oubli du destin
7 :00 – Je me réveille dans mon petit appartement de San Jerónimo. Je repense à l’expérience incroyable que j’ai vécu à Mito ces derniers jours et je me demande si tout cela n’a pas été qu’un rêve. Cependant, les courbatures terribles qui assaillent mes mollets en me levant sont là pour balayer ces doutes d’un revers de la main. Au moment de partir pour la station de bus, je réalise que, dans l’ivresse du moment, nous n’avons pas pris de photo souvenir avec mes deux anges gardiens, Lucho et Benito. Ça me rend un peu triste mais c’est comme ça. Je vérifie que je n’ai rien oublié, mon téléphone, mes clés, ma carte bancaire. Ma carte bancaire ! Où est-elle ? Je m’affole quelques secondes quand soudain, je me souviens qu’elle est restée dans la poche arrière de mon pantalon de huacón que j’ai laissé à Mito. J’appelle Lucho pour l’avertir. Heureusement, il est déjà debout et me répond immédiatement. Il s’amuse de la situation. « Le destin fait bien les choses », me dit-il. Je ne peux être plus d’accord. Je raccroche et regarde Elvis.
- Tu peux m’emmener rapidement en voiture ?
- Non, je suis vraiment désolé mais je n’ai pas ma voiture aujourd’hui…
Il réfléchit quelques secondes.
- Allons-y en moto !
Je n’ai pris la moto que deux fois dans ma vie et je dois dire que je ne suis pas un grand fan de ce type de transport mais l’heure n’est pas aux tergiversations. Je monte avec Elvis et je laisse mes peurs sur le bas-côté. Nous sortons de San Jerónimo et nous prenons de nouveau la route direction Mito. Je me détends peu à peu et me laisse bercer par le vent frais du matin qui caresse mon visage. Je m’oublie face à la splendeur de la vallée du Mantaro. Je pense à l’expérience incroyable que je viens de vivre à Mito, puis je pense à mes ancêtres qui ont vu ces paysages avant moi. Pendant ce bref instant, la vie est d’une douceur infinie. Roule ma poule !

Moi, Benito et Lucho (de gauche à droite) dans le jardin de Benito.
C’est ici que s’achève la troisième et dernière partie de mon voyage initiatique dans la vallée du Mantaro. Je suis triste de quitter Lucho, Percy, Benito et cette terre de Mito qui m’a tant apporté. J’aurais aimé rester plus longtemps mais une autre aventure m’attend à Lima, je m’apprête à commencer une formation intensive en danse d’un mois à l’École Nationale de Folklore. Je ne le sais pas encore, mais c’est loin d’être la dernière fois que je reverrais mes chers compagnons de fortune. Je quitte la vallée du Mantaro avec le rythme de la Huaconada qui résonne inlassablement dans mon esprit.
Cher Tom et chère Jade, j’espère avoir réussi à vous transporter dans ces terres lointaines à l’histoire fascinante et vous avoir fait vivre un peu de ce qu’est la Huaconada de Mito, une tradition millénaire qui perdure jusqu’à nos jours. Je pense fort à vous et vous embrasse tendrement.
Gabriel
P.S. Cette année, j’ai pu revenir à Mito pour participer de nouveau à la fête de la Huaconada et ainsi tenir la promesse que j’avais faite à Lucho l’an passé. Cela me tenait particulièrement à cœur, tant par respect vis-à-vis des personnes que j’ai rencontré à Mito, qu’à l’égard de la tradition, d’autant plus que celle-ci veut qu’une fois que l’on est baptisé huacón, il faut revenir 7 ans de suite pour ne pas perdre ce statut. Même si j’imagine qu’il est impossible pour de nombreuses personnes de se tenir à cette règle, celle-ci cherche avant tout à responsabiliser les nouveaux huacones afin que cette tradition ancestrale perdure dans le temps. Cette fois ci, j’ai pu participer à la fête les trois jours durant, et danser en tant que huacón confirmé. J’ai même acheté mon costume tout entier pour l’occasion. J’ai choisi la couleur rouge en référence à mon nom de baptême : Puka Amaru (« serpent rouge » en quechua). Quant au masque, Lucho m’en a gentiment offert un de sa propre confection. J’ai aussi pu pallier l’un des seuls regrets que j’avais nourri lors de ma première expérience en tant que huacón, celui de n’avoir aucune photo ni vidéo immortalisant ce moment. Cette fois ci, j’ai prévu le coup et j’ai demandé à ce qu’on prenne plusieurs photos de moi en costume de huacón. Ce retour à Mito à l’occasion de la Huaconada a confirmé mon goût pour cette danse mystique et l’importance que j’accorde à cette tradition millénaire. J’espère pouvoir revenir encore à de nombreuses reprises pour revoir mes amis miteños et tenir mon engagement vis-à-vis du dieu Kon.

Remerciements
Je remercie chaleureusement Lucho d’avoir été un ami et un guide d’une générosité absolue. Je remercie également Percy, Benito, Robert et Loly pour m’avoir guidé admirablement dans cette tradition formidable qu’est la Huaconada. Enfin, je remercie l’ensemble de la famille Inga Picho et les nombreux miteños dont j’ai croisé le chemin pour la générosité dont ils ont toujours fait preuve à mon égard.
Annexe - Petite histoire d’une tradition millénaire
D’après un huacón expérimenté avec qui j’ai pu échanger, ce qui fait la singularité de la Huaconada, c’est qu’elle est millénaire, mystique et moraliste. En effet, la Huaconada est une tradition ancestrale qui remonte à l’époque préhispanique, ce qui en fait l’une des traditions les plus anciennes du Pérou. Selon Gary, l’historien du village qui possède un musée dédié à la Huaconada [cf. partie 2/3], on peut percevoir l’influence de la culture préhispanique Chavín (1200 av. J.-C. – 400 av. J.-C.) dans les traits du masque du huacón. Ainsi, ce dernier se caractériserait par une tripartition typique de la religiosité andine entre le monde d’en haut (hanan pacha en quechua), le monde terrestre (kay pacha en quechua), et le monde d’en bas (uku pacha en quechua) représentés respectivement par le condor, le jaguar et le serpent. Par exemple, le nez aquilin rappellerait le bec du condor tandis que la bouche et les dents aiguisées imiteraient la mâchoire du jaguar.
D’après de nombreux miteños, cette pratique rituelle prend sa source dans la région préhispanique de Yakowasi qui englobait Mito et ses alentours (Mito n’existait pas alors, le village fut créé par les Espagnols comme en témoigne le tracé géométrique de ses rues). À cette époque, les huacones sortaient des hauteurs les premiers jours de l’année pour punir tous ceux qui s’étaient mal comportés au cours de l’année, les maris violents et infidèles en particulier, et ils ne retiraient jamais leurs masques pour ne pas être identifiés. À l’origine, la Huaconada n’est donc pas une danse mais une pratique rituelle de contrôle social. D’après Simeón Orellana Valeriano, l’un des principaux historiens de la Huaconada, cette pratique était également empreinte d’une dimension mystique liée au Dieu Kon à l’origine, ce qui pourrait expliquer l’étymologie du terme huacón. Si cette relation est difficile à vérifier, on peut cependant affirmer avec assurance que la Huaconada n’entretient aucun lien avec la religion catholique apportée par les Espagnols. Comme me l’a dit un miteño du nom de José : « D’un côté il y a la Huaconada, de l’autre il y a le Seigneur. » Comme ce fut le cas pour l’ensemble des croyances préhispaniques, la Huaconada a fait l’objet d’une volonté d’extirpation de la part des Espagnols, celle-ci étant considérée comme une tradition païenne, mais face à la résistance des huacones, elle fut tolérée progressivement, d’autant plus que les valeurs morales qu’elle incarnait étaient conformes au dogme catholique. Progressivement, la fonction sociale qui caractérisait la Huaconada s’est dilué et celle-ci s’est convertie en une danse et une fête rituelle. Malgré tout, celle-ci conserve son esprit originel à travers le personnage du huacón qui incarne l’autorité morale de l’ancien conseil des anciens du village.
Par ailleurs, d’après le sociologue et fondateur du groupe théâtral Yuyachkani Miguel Rubio [3], le personnage du huacón, aux côtés d’autres personnages encore existants dans la région andine comme le Kusillo et le Machutusuj, serait emblématique de ce qu’il appelle la théâtralité andine, une tradition théâtrale ancestrale propre à la région andine qui se caractérise notamment par l’absence de séparation entre acteur et danseur [4]. Ce caractère ancestral de la Huaconada, en plus de sa dimension mystique et moraliste, a été déterminant pour que l’UNESCO élève cette tradition au rang de « Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité » en 2010. Depuis cette reconnaissance prestigieuse, la Huaconada de Mito a gagné considérablement en popularité, devenant célèbre dans la région de Huancayo et au-delà. Ainsi, la fête s’est répandue dans les communes des alentours de Mito telles que Concepción ces dernières années. Toutefois, c’est à Mito que la tradition est considérée comme la plus authentique.
Pour conclure cet encadré historique, j’aimerais revenir rapidement sur la dimension genrée de la Huaconada. Comme de nombreuses de traditions, la Huaconada n’est pas imperméable au machisme. En effet, seul les hommes ont le privilège de devenir huacón jusqu’à aujourd’hui. Pourtant, cela ne fait aucun doute que de nombreuses femmes aimeraient avoir cette possibilité. On m’a ainsi raconté que certaines femmes avaient déjà enfreint cette règle en se déguisant en huacón et en allant danser sur la place principale de Mito. Lorsque celles-ci sont démasqués cependant, elles s’exposent à une punition pouvant être sévère comme toute personne ne respectant pas la tradition, bien que les femmes sont épargnées par les coups de fouet, en principe. Aucune tradition n’est immuable, et peut être qu’avec le temps, la Huaconada s’ouvrira pour ne plus être réservée exclusivement aux hommes. On peut ainsi imaginer un monde où les femmes puissent devenir huacón, ou alors encore mieux, qu’on puisse voir émerger un personnage de huacón féminin, qui sait ?
Pour aller plus loin…
Lectures
UNESCO, « La Huaconada, danse rituelle de Mito » : https://ich.unesco.org/fr/RL/la-huaconada-danse-rituelle-de-mito-00390?RL=00390
La Huaconada de Mito de Soledad Mujica Bayly, une excellente introduction sur l’histoire de cette tradition et la manière dont elle est réalisée aujourd’hui
La Danza de los sacerdotes del dios kon: la Huaconada de Mito de Simeón Orellana Valeriano, une étude fouillée sur les origines préhispaniques de la Huaconada
Films
Documentaire La Mascara y Más de J. Ashley Nixon (66 min), en accès libre au lien suivant : https://vimeo.com/jashleynixon
Notes de bas de page
1. J’ai fait le choix de conserver la majuscule au terme Huaconada comme c’est l’usage en espagnol. Le terme peut se référer à la fois à la fête, la tradition ou la danse. Dans la plupart des cas, je donnerais des précisions sur le sens auquel je me réfère.
2. Túpac Amaru II fut un cacique indien qui prit en 1780 la tête d'un mouvement de rébellion indien contre les colons espagnols au Pérou. Le mouvement échoua et Túpac Amaru fut publiquement écartelé et décapité en 1781 à Cuzco. Cependant, il devint par la suite une figure mythique de la lutte péruvienne pour l'indépendance et pour la reconnaissance des droits des indigènes, et sera reconnu comme le fondateur de l’identité nationale péruvienne. Aujourd’hui encore, il représente un symbole d’insoumission populaire qui est souvent revendiqué Pérou.
3. Le groupe de théâtre Yuyachkani est une troupe emblématique du théâtre péruvien et latinoaméricain contemporain. Fondé en 1971, le groupe Yuyachkani a réalisé un nombre important d’œuvres théâtrales dont la plupart tendent à avoir un contenu politique, social ou culturel, en essayant d'être représentatives de la réalité andine du pays et avec un intérêt particulier pour le sujet de la violence interne subie au Pérou dans les années 80 et 90. Ses pièces sont créées collectivement et reposent sur une philosophie basée sur un projet de vie commun de ses membres.
4. Rubio, Miguel (2009). "En busca de la teatralidad andina". Fiestas y rituales. X Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos, p. 245-262. https://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/En-busca-de-la-teatralidad-andina.-Por-Miguel-Rubio.pdf



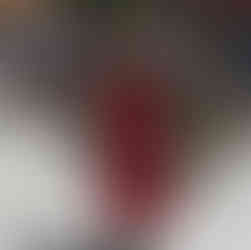

























Coucou Gabriel
Merci pour ce magnifique texte qui nous fait voyager et découvrir le Pérou. J'espère que tu continueras à nous faire partager la vie culturelle et humaine du Pérou.
Bises
Stéphane le vieux barbu 😜
bravo Gabou por ese extraordinario viaje que nos haces vivir .. cultural místico y tan humano ... es un verdadero placer leerte...el entusiasmo que manifiestas en tus escritos es comunicativo ... sigamos contigo ese viaje por el Perú de hoy y el de ayer que siempre en los Andes son indisociables .
un abrazo y como lo decía tu abuelo Manuel ADELANTE